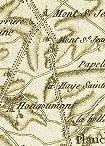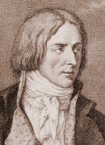![]()
.
Notice historique sur le général Marbot |
||||
par Cuvillier-Fleury* (1854) |
||||
| * Critique littéraire du Journal des Débats. |
|
Nouvelles études historiques et littéraires: par Cuvillier-Fleury, Paris 1855. pp. 344 - 356. |
||||
| Le général Marbot. — 22 novembre 1854. — Le nom de Marbot
avait été doublement inscrit dans l'histoire de la
Révolution et de l'Empire. Le père du général
qui vient de mourir (1), ancien aide de camp de M. Schomberg, député
de la Corrèze à l'Assemblée constituante, avait
commandé la première division militaire, présidé
le Conseil des Anciens, et il était mort des suites d'une
blessure qu'il avait reçue au siège de Gênes.
Ce fut pendant cette campagne, si fatale à son père,
que Jean-Baptiste-Marcellin de Marbot fit le premier apprentissage
de la guerre, comme simple soldat au 1er régiment de hussards.
Il était né le 18 août 1782, au château
de La Rivière (Corrèze), et il n'avait que dix-sept
ans quand il entra au service. Un mois plus tard, à la suite
d'un brillant fait d'armes, il fut nommé sous-lieutenant ;
et c'est ainsi que s'ouvrit pour lui, entre cette perte irréparable
qui lui enlevait son plus sûr appui et cette promotion rapide
qu'avait méritée son courage, la rude carrière
où il devait s'illustrer. |
||||
Marbot appartenait à cette génération qui n'avait que très peu d'années d'avance sur le grand mouvement de 89, et pour laquelle la révolution précipitait pour ainsi dire la marche du temps ; car il faut bien le remarquer ici : parmi ceux qui, voués au métier des armes, devaient porter si haut et si loin la gloire du nom français, tous n'avaient pas eu le même bonheur que le jeune Marbot. L'ancien régime faisait payer cher aux plus braves le tort d'une origine obscure et d'une parenté sans blason. On attendait quelquefois quinze et vingt ans une première épaulette. Plusieurs quittaient l'armée faute d'obtenir un avancement mérité. Ce fut ainsi que Masséna prit son congé le 10 août 1789, après quatorze ans de service comme soldat et sous-officier. Moncey mit treize ans à gagner une sous-lieutenance. Soult porta six ans le fusil. Bernadotte ne fut sous-lieutenant qu'après avoir passé dix ans dans le régiment de Royal-Marine. Il mit à peine le double de ce temps-là, une fois la révolution commencée, pour devenir de sous-lieutenant roi de Suède (2). Marbot, soldat en 1799, était déjà capitaine en 1807. On lui avait tenu compte des canons qu'il avait enlevés aux Autrichiens, dans une brillante charge de cavalerie, pendant la seconde campagne d'Italie ; on lui avait su gré de l'énergique activité de ses services comme aide de camp du maréchal Augereau pendant la bataille d'Austerlitz.Ce fut donc comme capitaine qu'il fit la campagne d'Eylau. Pendant la bataille de ce nom, et au moment le plus critique de cette sanglante journée, Augereau lui donna l'ordre de se rendre en toute hâte sur l'emplacement qu'occupait encore le 14e de ligne, cerné de tous côtés par un détachement formidable de l'armée russe, et d'en ramener, s'il le pouvait, les débris. Mais il était trop tard. Pourtant Marbot, grâce à la vitesse de son cheval, et quoique plusieurs officiers du maréchal, porteurs du même ordre, eussent rencontré la mort dans cette périlleuse mission, Marbot pénètre jusqu'au monticule où, pressés de toutes parts par un ennemi acharné, les restes de l'infortuné régiment tentaient leur dernier effort et rendaient leur dernier combat. Marbot accourt ;il demande le colonel ; tous les officiers supérieurs avaient péri. Il communique à celui qui commandait à leur place, en attendant de mourir, l'ordre qu'il avait reçu. Cependant les colonnes russes, débouchant sur tous les points et bloquant toutes les issues, avaient rendu toute retraite impossible... « Portez notre aigle à l'Empereur, dit à Marbot, avec d'héroïques larmes, le chef du 14e de ligne, et faites-lui les adieux de notre régiment en lui remettant ce glorieux insigne que nous ne pouvons plus défendre.... » Ce qui se passa ensuite, Marbot ne le vit pas : atteint par un boulet qui le renversa sur le cou de son cheval, puis emporté par l'animal en furie hors du carré où le 14e achevait de mourir jusqu'au dernier homme, l'aide de camp d'Augereau fut renversé quelques moments après, puis laissé pour mort sur la neige, et il eût été confondu dans le même fossé avec les cadavres qui l'entouraient, si un de ses camarades ne l'eût miraculeusement reconnu et ramené à l'état-major, |
||||
Le
général Marbot racontait parfois, et avec une émotion
communicative, ce dramatique épisode de nos grandes guerres ;
et c'est bien le lieu de faire remarquer ici tout ce qu'il mettait
d'esprit, de verve, d'originalité et de couleur dans le récit
des événements militaires auxquels il avait pris part :
il n'aimait guère à raconter que ceux-là. Précision
du langage, vigueur du trait, abondance des souvenirs, netteté
lumineuse et véridique, don de marquer aux yeux par quelques
touches d'un relief ineffaçable les tableaux qu'il voulait
peindre, rien ne manquait au général Marbot pour intéresser
aux scènes de la guerre les auditeurs les plus indifférents
ou les plus sceptiques. Son accent, son geste, son style coloré,
sa vive parole, cette chaleur sincère du souvenir fidèle,
tout faisait de lui un de ces conteurs si attachants et si rares
qui savent mêler au charme des réminiscences personnelles
tout l'intérêt et toute la gravité de l'histoire. La Restauration
était trop intelligente pour garder longtemps rancune à
la gloire de l'Empire. Elle pouvait la craindre, mais elle l'admirait.
La lettre de Vérone, dans laquelle le sage roi Louis XVIII
avait rendu un si grand témoignage au héros d'Arcole
et des Pyramides, était toujours le fond de sa politique
à l'égard des serviteurs du régime impérial.
Le général Rapp était un aide de camp du roi.
Les maréchaux de Napoléon commandaient ses armées.
Marbot fut rappelé de l'exil et nommé au commandement
du 8e régiment de chasseurs à cheval. Déjà,
en 1814, et très peu de temps après le rétablissement
de la monarchie des Bourbons, le colonel Marbot avait été
appelé à commander le 7e de hussards, dont M. le duc
d'Orléans était alors le colonel titulaire. Cette
circonstance avait décidé en lui le penchant qui le
rapprocha depuis de la famille d'Orléans, et qui plus tard
l'engagea irrévocablement dans sa destinée. Homme
de cœur et d'esprit comme il l'était, attaché plus
encore peut-être par sa raison que par sa passion à
ces principes de 89 et à ces conquêtes de la France
démocratique que la Charte de 1814 avait consacrés,
— esprit libéral, cœur patriote, Marbot s'était senti
tout naturellement entraîné vers un prince qui avait
pris une part si glorieuse en 1792 aux premières victoires
de l'indépendance nationale et qui, le premier aussi, en
1815, avait protesté du haut de la tribune de la pairie contre
la réaction et les proscripteurs. Aussi, quand le duc de
Chartres fut en âge de compléter par des études
militaires la brillante et solide éducation qu'il avait reçue
à l'Université, sous la direction d'un professeur
éminent, ce fut au colonel Marbot que fut confiée
la mission de diriger le jeune prince dans cette voie nouvelle ouverte
à son intelligence et à son activité ;
et tout le monde sait que le disciple fit honneur au maître.
Dès lors le général Marbot (le roi l'avait
nommé maréchal de camp après la révolution
de Juillet) ne quitta plus le duc d'Orléans jusqu'à
sa mort, et il le servit encore après, en restant attaché
comme aide de camp à son jeune fils. Devant le canon d'Anvers
en 1831 ; plus tard, en 1855, pendant la courte et pénible
campagne de Mascara où il commanda l'avant-garde ; en
1839, pendant l'expédition des Portes-de-Fer ; en 1840,
à l'attaque du col de Mouzaïa, — partout Marbot garda
sa place d'honneur et sa part de danger auprès du prince,
et il reçut sa dernière blessure à ses côtés,
« ... C'est votre faute si je suis blessé !,
dit-il en souriant au jeune duc, comme on le rapportait à
l'ambulance. — « Comment cela? dit le prince. — Oui, monseigneur;
n'avez-vous pas dit au commencement de l'action : Je parie que si
un de mes-officiers est blessé, ce sera encore Marbot ?
Vous avez gagné !... » C'était
là, il faut bien l'avouer, une opinion un peu métaphysique
pour l'époque où le général Rogniat
écrivait, et qui, fût-elle fondée (ce que je
ne crois pas), n'était ni utile à répandre
ni bonne à dire. Le général Marbot avait été fidèle à l'Empire jusqu'à souffrir, en mémoire de cette glorieuse époque, la proscription et l'exil. Nous avons vu comment la Restauration lui rendit à la fin justice, et comment la dynastie de Juillet lui donna sa confiance. La révolution de Février le mit à la retraite. Le général Marbot se résigna. Il accepta sans se plaindre une disgrâce qui le rattachait encore à la royauté déchue. Il avait la qualité des nobles cœurs, il était fidèle. Le souci très éclairé et très intelligent du père de famille n'avait jamais affaibli chez lui le citoyen ni le soldat. Après avoir été un des héros de l'épopée impériale, il fut un des personnages les plus considérables et les plus favorisés de la monarchie de Juillet ; et il s'en est souvenu jusqu'à son dernier jour, non sans un mélange de douloureuse amertume, quand il songeait à cette jeune branche d'un tronc royal, brisée fatalement sous ses yeux, mais avec une imperturbable sérénité de conscience, en songeant aussi qu'il n'avait jamais cessé, depuis soixante ans, de servir son pays sur tous les champs de bataille, dans toutes les rencontres sérieuses, dans l'armée, dans le parlement, dans les affaires publiques, dans l'éducation d'un prince, et jusque dans ces derniers et trop courts loisirs de sa verte vieillesse, consacrés au récit de nos grandes guerres et au souvenir de nos victoires immortelles. |
||||
| (1)
Le 16 novembre 1854. (2) Voir les Portraits militaires de M. de La Barre-Duparcq, p. 23. Paris, 1853. (3) Remarques critiques sur l'ouvrage de M. le lieutenant-général Rogniat, intitulé : Considérations sur l'art de la guerre, par le colonel Marbot (Marcellin), Paris, 1820. Marbot écrivit aussi en 1825 un autre ouvrage qui eut alors un certain retentissement et qui le méritait; il est intitulé : De la nécessité d'augmenter les forces militaires de la France. (4) Paragr. 2, n° 31, du testament de Napoléon. Le legs de l'Empereur à Marbot était de cent mille francs. (5) Voir le chapitre intitulé : Des grandes opérations offensives, p. 597 et suivantes de l'ouvrage précité. (6) Considérations sur l'art de la guerre, p. 410. (7) Remarques critiques, etc., p. 591, 592. |
|
|
![]()