| Accueil
Annuaire
Faits et événements
Personnages
Napoléon
La France et le Monde
Waterloo
Belgique
Armées
Uniformes
Reconstitution
Publications
Liens
Nouvelles du Jour
Plan du site
Balises
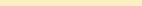



|
.
| |
Lettre
de Jérôme Bonaparte |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Le 15 juillet
1815, moins d'un mois après la bataille de Waterloo, Jérôme
Bonaparte, réfugié au château de Douy en Touraine,
propriété du frère du financier Ouvrard, attendant
que les événements politiques lui permettent de quitter
la France en sécurité, écrivit une lettre à
son épouse, la reine Catherine, dans laquelle il racontait
la part qu'il avait prise à la campagne.
Cette lettre fut publiée pour la première fois par le
baron Albert du Casse, aide de camp de Jérôme Bonaparte
sous le second Empire, lorsqu’il publia les « Mémoires
du roi Jérôme* ». |
|
|
|
| |
Sainte-Beuve,
dans ses Nouveaux Lundis, écrit au sujet de la publication
des Mémoires du roi Jérôme par Du Casse
:
« Ces Mémoires, rédigés avec le plus
grand soin sous les yeux de S.A.I. le prince Napoléon, et
reposant tout entiers sur les pièces d’Etat et de famille
les plus authentiques, dont on produit les plus importantes à
l’appui du récit, à la suite de chaque livre, deviennent
une des sources nouvelles et essentielles de l’histoire de ce temps.
» (*Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, Tome neuvième, 1867
p. 224)
La lettre du 15 juillet 1815 diffère évidemment sur
de nombreux points de la version mise au point par Napoléon
à Sainte-Hélène. C’est pourquoi Du Casse a
cru nécessaire de la commenter de la façon suivante
:
« Les événements, les prévisions,
les jugements sont présentés, dans ces curieuses lettres,
au jour le jour, sous l’impression du moment, la plupart du temps
en dehors de la connaissance des résultats définitifs
et même de cette vérité historique des faits
qui, plus souvent qu’on ne le pense, échappe aux contemporains
et est retrouvée par la postérité. Il ne faut
donc pas s’étonner du contraste que présentent certaines
opinions de Jérôme et Catherine sur les faits ou sur
les hommes, avec celles que l’histoire, éclairée par
une longue et patiente critique, et surtout par la suite des événements,
a pu faire prévaloir et accepter comme vraies. »
Cette prudente mise au point apparaît plutôt comme une
précaution pour empêcher que le lecteur ne se rende
compte du contraste entre les faits réels et ceux qui sont
acceptés par l’histoire officielle.
L’original
de la lettre est conservé aux Archives nationales à
Paris (*Jérôme Bonaparte, Lettre à la reine
Catherine, 15 juillet 1815, Archives nationales, Paris, 400AP/88.)
. La comparaison entre l’original et la transcription par Du Casse
ne manque pas d’intérêt. Si Du Casse reproduit fidèlement
la lettre, on remarque néanmoins qu’il a supprimé
un petit passage à la fin de la lettre, un passage d’une
extrême importance, puisqu’il dit à son épouse,
de façon confidentielle, que Napoléon a perdu la tête
à la fin de la bataille...
Cet important témoignage, provenant de la personne qui lui
était le plus proche, adressé sous le sceau de secret
à la personne qui lui était la plus chère,
présente toutes les garanties d’authenticité. Mais
elle risquait de mettre à mal l’image de Napoléon
sur laquelle était basée le régime du Second
Empire, et il était donc hors de question de laisser cette
phrase dans la publication des Mémoires de Jérôme
Bonaparte.
On remarquera
que le prince Jérôme, censé avoir mené
avec acharnement les attaques contre la ferme de Hougoumont, ne
semble même pas soupçonner qu'il y avait une ferme
derrière ce bois, dans lequel il envoyait ses soldats se
faire massacrer.
Etrange...
Ni dans le bulletin dicté par
Napoléon, ni dans le discours
de Drouot il n'est fait la moindre mention de la ferme ni du
château de Hougoumont. Et le général Foy, qui
commande la division qui appuyait Jérôme, ne parle
que de "maisons" derrière le bois (voir sa relation),
ce qui montre que l'état-major français n'avait pas
une idée nette de ce que cachait le bois de Hougoumont. Mais
comment aurait-il pu l'avoir, sans avoir effectué de reconnaissance
sérieuse, alors que la carte dont il disposait était
sommaire et dépassée ? |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
(*Mémoires
et correspondance du roi Jérôme et de la reine Catherine,
publiés par le baron Du Casse, tome VII, Paris 1866.)
|
|
|
|
| |
Extrait de la lettre de Jérôme Bonaparte à Catherine
de Wurtemberg, du 15 juillet 1815 : |
|
|
|
| |
(...)
La journée du 17 fut employée à la poursuite
de l’ennemi qui, sur le soir prit position en avant de la forêt
de Soignes, au mont Saint-Jean : le temps était affreux.
Toute la nuit du 17 au 18 fut employée à réunir
l’armée et à prendre les dispositions pour le lendemain.
Le 18 au matin, en passant devant le quartier général
de l’Empereur, je m’arrêtai une heure avec lui, il me reçut
avec une affection et une tendresse toute particulières,
il assembla les principaux généraux, et une fois le
plan de bataille arrêté, chacun se rendit à
son poste. A midi toute l’armée était en ligne ; j’étais
à l’extrême gauche, devant un bois occupé par
les Anglais : nous avions soixante-dix mille hommes et deux cent
quatre-vingts pièces de canon ; l’ennemi en avait quatre-vingt
seize mille ; le maréchal Grouchy, avec trente-six mille
hommes, observait l’armée prussienne sur notre extrême
droite, mais n’était pas en communication avec nous.
A midi un quart, je reçus l’ordre de commencer l’attaque
; je marchai sur le bois que j’occupai à moitié après
une vive résistance, tuant et perdant beaucoup de monde ;
à deux heures j’étais entièrement maître
du bois, et la bataille était engagée sur toute la
ligne : mais l’ennemi qui sentit toute l’importance de ce point,
accourut avec une réserve et me l’enleva. Je m’y portai avec
toute ma division, et à trois heures, après le plus
sanglant combat, je le repris de nouveau, et depuis je le gardai
jusqu’à la fin de la bataille. L’ennemi laissa dans ce bois
six mille morts, et moi deux mille avec un de mes généraux
et presque tous mes officiers supérieurs ; de plus, les blessés
et les pertes que j’avais faites à la bataille du 16 me réduisirent
à deux bataillons. Je reçus l’ordre de l’Empereur
de me rendre auprès de lui : il me reçut encore mieux
que la veille, et me dit : “Il est impossible de se mieux battre
; actuellement qu’il ne vous reste plus que deux bataillons, demeurez
pour vous porter partout où il y aura du danger.” L’affaire
allait à merveille ; il était trois heures, nous avions
déjà gagné beaucoup de terrain sur l’ennemi,
qui en était à sa dernière position : c'est
alors que l'Empereur ordonna au maréchal Ney de se porter
avec une grande partie de la cavalerie, deux corps d'infanterie
et la garde sur le centre de l'ennemi pour donner le coup de massue
et certes c'en était fait de l'armée anglaise si le
maréchal eût exécuté les ordres de l'Empereur
; mais Ney, emporté par son courage, et par l'espoir de réussir
sans la garde, n'attendit pas son arrivée, et attaqua ¾
d'heure plus tôt : j'étais auprès de l'Empereur
lorsqu'il vit la faute du maréchal : il me dit ces mots
: "Le malheureux c'est la seconde fois depuis avant-hier qu'il
compromet le sort de la France." L'attaque manqua, cela devait
être : c'était le moment décisif et il fallait
le concours de la garde pour assurer le succès : les Anglais
déjà ébranlés reprirent leur position.
Cependant l'Empereur calme et froid au milieu de tous ces événements
répara par son génie la faute du maréchal Ney,
par un mouvement qu'il fit lui-même en avant avec une partie
de la réserve : nous nous battions ainsi avec acharnement
sans gagner ni perdre du terrain, lorsqu'à six heures une
canonnade à deux lieues sur notre droite nous fit croire
que le maréchal Grouchy débouchait. (C'étaient
les Prussiens) : le moment était critique, il fallait ou
se retirer, ou notre droite, débordée par les Prussiens,
que Grouchy n'était point assez fort pour maintenir, nous
faisait perdre la bataille : il fallait donc chasser l'armée
anglaise de ses positions pour pouvoir tomber sur les Prussiens
et arrêter leur mouvement en avant : L'Empereur, (ajout :
espérant que Grouchy arriverait), nous dit : "La bataille
est gagnée, il faut occuper les positions de l'ennemi ; marchons " ;
et tout à l'exception de six bataillons de vieille garde
marcha avec nous. Ney reçut quatre régiments (ajout :
de la garde), commandés par le général Friand,
et arriva sur les canons anglais ; nous soutenions au pied de la
position avec d'autres troupes, tout allait bien, Friand est blessé,
et par je ne sais quelle fatalité l'attaque (ajout :
de la garde) manqua !!! la garde fut ramenée... il fallut
battre en retraite, mais il n'était plus temps, l'Empereur
voulut se faire tuer ; nous étions au milieu des balles et
des ennemis, Wellington avait une cavalerie toute fraîche
qu'il lâcha dans la plaine à huit heures, à
neuf heures une terreur panique s'empara de l'armée, (ajout :
à dix heures) c'était une déroute, nos pièces
manquaient d'approvisionnements, etc., etc. L'Empereur fut entraîné,
personne ne donnait d'ordre et plus d’un mettait le désordre
préparé de longue main ; chacun courut jusque
derrière la Sambre : j'arrivai à Avesnes le lendemain,
ayant constamment fait l'arrière-garde avec un bataillon
et un escadron : je ne trouvai dans cet endroit, ni l’Empereur ni
les maréchaux qui avaient pris les devants ; je fis
des efforts inouïs pour rallier les débris de l’armée,
je parvins enfin à mettre ensemble dix-huit mille hommes
d’infanterie et trois mille de cavalerie, ainsi qu’une douzaine
de pièces de canon avec lesquelles j’arrivai à Laon
le 21 juin ; le maréchal Soult s’y trouvait, il me croyait
seul et ne pouvait ajouter foi que j’eusse avec moi autant de monde,
et lorsqu’un de mes officiers d’ordonnance arriva à Paris
pour rendre compte de ce heureux résultat, le maréchal
Ney, qui y était depuis plusieurs jours, soutint dans la
Chambre des Pairs que cela était impossible.
Le duc de Dalmatie, en sa qualité de major-général,
réclama le commandement : je le lui remis et me rendis
le 22 à Soissons, où je reçus une lettre du
ministre de la guerre qui me remerciait de l’heureux résultat
que j’avais obtenu et m’engageait de continuer à rallier
l’armée : le ministre ne savait pas alors que le maréchal
Soult avait pris le commandement.
Je me rendis à Paris, où j’appris, et l’avènement
de Napoléon II au trône impérial, et l’inexplicable
abdication de l’Empereur son père !
Il ne m’appartiendrait pas, Chère Trinette, de parler des
fautes de l’Empereur, si je n’étais certain que cette lettre
ne sera lue que par toi seule.
L’Empereur a été sublime jusqu’à huit heures
du soir, le jour de la bataille ; mais à neuf heures
ce n’était plus le même homme…..
Il pouvait, il devait se porter à l’armée de Grouchy,
et non courir à Paris, rallier les restes de son armée,
réparer nos pertes par les vingt mille hommes qui se trouvaient
dans les dépôts, rappeler Suchet et Lamarque, et réunissant
ainsi encore cent trente mille hommes, donner une grande bataille
sous les murs de Paris, ou bien faisant noblement le sacrifice de
sa personne, abdiquer en couronnant son fils, mais ne quitter ni
son armée, ni sa capitale qu’après s’être assuré
de la reconnaissance des puissances alliées : son fils
aurait régné ; c’était le vœu unanime
de toute la France : je dois t’avouer, ma chère amie,
que je ne trouve pas que l’exemple de Thémistocle justifie
la fin qu’il a faite : d’ailleurs il était beau de mourir
sous les murs de sa capitale en défendant son trône
et son pays.
La grande faute de l’Empereur, c’est d’avoir laissé les Chambres
assemblées pendant son absence, et de n’avoir pas été
convaincu qu’il lui était impossible de tirer la France d’une
crise aussi dangereuse sans avoir un pouvoir illimité. Rome
si jalouse de sa liberté ne s’est sauvée dans les
grands périls qu’en remettant toute l’autorité à
un seul : et j’avoue que je suis encore à m’expliquer
comment il s’est fait qu’un grand génie ait pu commettre
une pareille faute. Du reste s’il est vrai que les Anglais aient
violé les droits sacrés de l’hospitalité en
l’envoyant à Sainte-Hélène comme prisonnier,
c’est une tâche à leur honneur national, et par une
pareille conduite, ils seraient loin de la générosité
de Xerxès, qui oublia la défaite de Salamine et tout
le mal qu’il avait éprouvé par Thémistocle
pour ne voir en lui qu’un grand homme malheureux : ô
temps ! ô mœurs ! !
Je te presse sur mon cœur, ainsi que mon fils, quand serons-nous
réunis ?
Ce 15 juillet 1815. |
|
|
|
| |
Le texte intégral
de la lettre de Jérôme Bonaparte a été
publié pour la première fois dans l'ouvrage "Les
Mensonges de Waterloo" de Bernard Coppens. |
|
|
|
- Retour
à la page Jérôme Bonaparte
_
Retour au haut
de la page.

|
![]()
![]()




