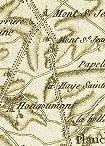![]()
|
Waterloo > |
.
Récit de la Bataille (suite) |
||||
|
||||
|
|
|
|||
Installé
sur la hauteur de Rossomme, Napoléon a devant lui ce qui sera le
champ de bataille, mais il s'en fait une image fausse. Le temps
est encore brumeux, et le relief et la végétation lui cachent la
physionomie réelle du terrain. Pour beaucoup, le "coup d'œil"
est une qualité essentielle d'un général. Ce 18 juin, Napoléon n'a
pas eu le "coup d'œil".
La description qu'il fera du terrain dans le bulletin dicté
le 20 le confirme. Baudus, un aide de camp de Soult,
décrira Napoléon "dans
une espèce d'apathie assez semblable à celle qu'on avait eu à lui
reprocher le jour de la bataille de la Moscowa ".
Mais Lachouque n'ose pas aller plus loin.
Pourtant, le bulletin de l'Empereur écrit le 20 montre que lui aussi
ignore ce que cache le bois d'Hougoumont. Et les lettres écrites
peu après par Jérôme et par Foy,
les deux généraux de division qui mènent les attaques contre la
position, montrent qu'eux non plus n'étaient pas conscients -même
après la bataille- de ce que recelait le bois. Au centre, la chaussée de Bruxelles s'enfonce
dans un bosquet d'arbres d'où dépassent, à gauche, quelques toits.
Napoléon croit qu'il s'agit de la ferme de Mont-Saint-Jean, qu'une
erreur sur la carte place d'ailleurs du côté gauche de la route.
Et le village de Mont-Saint-Jean n'est pas derrière la crête, comme
le croit l'Empereur, mais mille mètres plus loin. Un paysan de l'endroit
qu'on a réquisitionné comme guide, le cabaretier Decoster, qu'on
a dû lier sur un cheval, aurait pu sans doute éclairer Napoléon.
A la lecture de l'ordre dicté par Napoléon, et à la lecture du bulletin
rédigé à Laon, il est manifeste qu'il ne l'a pas fait. Napoléon
ne comprendra le terrain que quand il lira à Sainte-Hélène les relations
anglaises. En 1816, le général commandant le génie de l'armée écrira
encore que le centre de l'armée anglaise était "fortifié
par le village de Mont-Saint-Jean au nœud des routes de Charleroi
et de Nivelles à Bruxelles". Ce que Napoléon prend pour la ferme de Mont-Saint-Jean
est la ferme de la Haie-Sainte, occupée par le 2e bataillon léger
de la King's German Legion, et sommairement mise en état de défense.
Le général Haxo revient rendre compte de
sa reconnaissance, et dit qu'il n a pas aperçu de trace de fortification.
Haxo n'a pas bien regardé. Il y a un abattis et une barricade jetés
en travers de la route, à la hauteur de la Haie-Sainte, et le château
et la ferme de Hougoumont sont bel et bien fortifiés. Mais il n'était
pas allé voir ce qu'il y avait derrière le bois d'Hougoumont. Il
ne serait d'ailleurs probablement pas revenu. L'armée française prend position : le 1er
corps à droite de la route, depuis celle-ci jusque vers la Papelotte,
le 2e corps de l'autre côté de la route, la division
Jérôme à la gauche, touchant au bois de Hougoumont. Le 6e corps est placé en réserve, derrière
la droite du 1er corps. C'est la place que lui donne Napoléon dans
le bulletin, ainsi que la plupart des témoins. Dans la dictée de
1818, Napoléon le place plus au centre, à droite de la chaussée
de Bruxelles, et dans la dictée de 1820, à gauche de cette route.
Ce déplacement n'est pas dû à une mémoire défaillante, mais à une
volonté de la part de Napoléon de masquer ses fautes les plus importantes. A
onze heures, Napoléon dicte un ordre pour la bataille. Un des aides
de camp de Ney, le commandant Levavasseur,
a raconté la scène : Un
peu avant midi, l'Empereur dicte l'ordre que
Soult écrit sur son calepin, puis le major-général déchire la
feuille et la donne au maréchal Ney,
qui, avant de me la remettre pour la communiquer aux généraux en
chef, écrit en marge au crayon : "Le comte d'Erlon comprendra
que c'est lui qui doit commencer l'attaque. " L'ordre
dicté par Napoléon était le suivant : "Une fois que l’armée sera rangée en bataille, à peu près à 1 h.
après-midi, au moment où l’Empereur en donnera l’ordre au Maréchal
Ney, l’attaque commencera pour s’emparer du
village de Mont-Saint-Jean, où est l’intersection des routes. A
cet effet, les batteries de 12 du 2e corps et du 6e se réuniront
à celle du 1er corps. Ces 24 bouches à feu tireront sur les troupes
du Mont-Saint-Jean, et le Comte d’Erlon commencera l’attaque, en
portant en avant sa division de gauche et la soutenant, selon les
circonstances par les divisions du 1er corps. Le 2e corps s’avancera à mesure pour garder la hauteur du comte d’Erlon.
Les compagnies de sapeurs du premier corps seront prêtes pour se
barricader sur le champ à Mont-Saint-Jean. On
voit que pour l'Empereur, ce qu'il a devant lui, c'est le village
de Mont-Saint-Jean. La portée des pièces de 24, d'ailleurs, ne permettrait
pas d'atteindre le hameau à l'endroit où il se trouve réellement.
C'est donc que Napoléon croit que le village se trouve derrière
la crète. C'est aussi pour cette raison qu'il ordonne aux sapeurs
d'être prêts à se barricader sur-le-champ, ordre qui n'aurait pas
de sens si l'objectif était encore un kilomètre plus loin, avec
une armée anglaise à traverser ! Le
commandant Levavasseur s'élance pour porter l'ordre : Je pars par la gauche, au galop, et j'atteins d'abord le prince Jérôme,
dont les troupes occupent en masse un vallon, en arrière d'un petit
bois. Les
mots griffonnés par Ney étaient les suivants
: Le Comte d'Erlon comprendra que c'est par la gauche que l'attaque commencera,
au lieu de la droite. Communiquer cette nouvelle disposition au
Général en chef Reille. Ney
n'avait voulu que préciser l'ordre de Napoléon, il y a porté de
la confusion. D'après Reille et Levavasseur,
c'était la gauche du 1er corps, au centre de la première ligne,
qui était visée. Certains historiens, par contre, ont à tort interprété
ces mots comme voulant dire que c'était la gauche de l'armée, donc
la division Jérôme qui devait commencer
l'attaque. Il n'est donc pas étonnant que Jérôme
ait pu, lui aussi, mal interpréter l'ordre. Car il écrira, le 15
juillet :
"A midi un quart,
je reçus l’ordre de commencer l’attaque ; je marchai sur le bois
que j’occupai à moitié après une vive résistance, tuant et perdant
beaucoup de monde ; à deux heures j’étais entièrement maître du
bois, et la bataille était engagée sur toute la ligne"
Pourtant
l'ordre que lui porte Levavasseur dit bien que l'attaque commence
sur Mont-Saint-Jean. Et Reille, qui commande
le 2e corps, dira que Jérôme a outrepassé
les ordres. L'hypothèse d'une méprise de la part de Jérôme, due à la formulation imprécise de Ney, n'est pas à écarter. |
||||
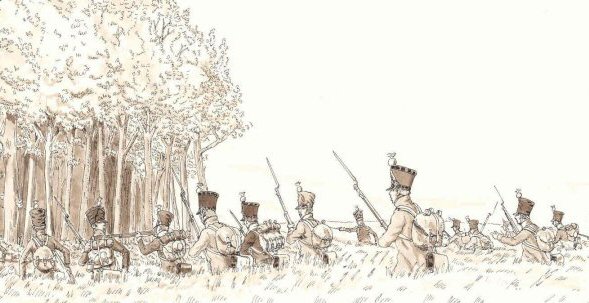 |
||||
|
La façon dont les attaques contre Hougoumont
ont été menées a toujours été un sujet d'étonnement pour tous les
militaires qui ont étudié la bataille. La seule explication plausible
est que Napoléon et ses généraux ne savaient pas ce que cachait
le bois d'Hougoumont. Ceci est confirmé par tous les récits écrits
après la bataille par les combattants français. Aucun, pas même
Foy et Jérôme n'ont
connaissance de ce qui s'est réellement passé dans ce bois où ils
envoyaient leurs troupes par petits paquets. Ce n'est qu'au cours
des combats qu'ils apprennent qu'il y a "des maisons, un village".
Mais aucun d'eux n'a conscience de la configuration réelle de l'ensemble,
un château et une ferme dont les bâtiments forment un rectangle
fortifié : "faillite de la liaison et des transmissions".
Quatre compagnies de Guards anglais occupent le château qu'ils ont
mis en état de défense pendant la nuit, un bataillon de Nassau et
deux compagnies hanovriennes occupent le bois et les abords. En 1816, le bois d'Hougoumont fut rasé,
et plus personne n'imagina
que Napoléon avait pu ne pas voir un obstacle qui n'était devenu
visible qu'un an après la bataille ! Dans ses Mémoires dictés à Ste Hélène, Napoléon
écrit qu'avant de donner le signal à la grande batterie, il aperçut
dans la direction de Saint-Lambert "un
nuage qui lui parut être des troupes". Ignorant s'il s'agissait
de Grouchy ou d'un corps prussien, il
aurait envoyé dans cette direction les divisions de cavalerie légère
de Domon et de Subervie. Un quart d'heure plus tard, un hussard
prussien fait prisonnier lui aurait été amené. Mais toute cette histoire est-elle vraie
? Sans même s'arrêter au fait que le temps brumeux ne permettait
pas de voir bien loin, et que des troupes sur un terrain détrempé
ne produisent pas de nuage, il semble que Domon, Subervie et le
6e corps n'aient pas fait mouvement à ce moment là. Est-ce bien à ce moment là que Napoléon
dicte à Grouchy la lettre que celui-ci
ne recevra qu'à sept heures, et qui contiendrait ce post-scriptum
: "Une lettre qui vient d'être interceptée porte que le général
Bülow doit attaquer notre flanc droit. Nous croyons apercevoir
ce corps sur les hauteurs de Saint-Lambert. Ainsi ne perdez pas
un instant pour vous rapprocher de nous et nous joindre, et pour
écraser Bülow que vous prendrez en flagrant
délit." Cette lettre ne se trouve pas dans le registre
du major-général, et plusieurs indices donnent à
penser que celle qui est connue a pu être "arrangée". La grande batterie "Je
ferai jouer ma nombreuse artillerie, avait dit l'Empereur. En
effet, une concentration de canons, qui devait originairement être
composée de 24 pièces de 12, fut augmentée par les batteries divisionnaires
pour arriver à constituer "la grande batterie", dont Napoléon
porte le chiffre à 80 pièces. Elle fut disposée sur une arête devant
la Belle-Alliance, à droite de la chaussée. La grande batterie ouvrit
le feu vers une heure pour préparer l'attaque du 1er corps. Mais
ce feu d'artillerie, qui ne pouvait se faire que par approximation
contre des troupes dissimulées à la vue, sur un terrain détrempé
où les boulets ne ricochaient pas, n'eut pas les effets qu'en attendait
Napoléon. Attaque
du 1er corps. Conformément
à l'ordre dicté à onze heures, Ney et le
comte d'Erlon lancent l'attaque contre les positions anglaises. Les
quatre divisions du premier corps d'armée sont rangées selon un
dispositif inhabituel, qui n'est pas prévu par le règlement : les
bataillons déployés alignés les uns derrière les autres formant
des masses compactes. Ce dispositif ne permet pas aux troupes de
prendre une formation défensive en cas d'attaque de la cavalerie.
Napoléon, dans ses dictées, n'a jamais critiqué la disposition adoptée.
C'est Jomini qui le premier y voit une des causes du désastre. Et
puisque faute il y avait, il convenait de trouver un responsable,
un coupable : Ney ou d'Erlon, (puisqu'il
était impossible d'imaginer que Napoléon ait pu commettre une telle
faute), lequel des deux pouvait avoir été assez inepte pour ordonner
une telle formation "macédonienne" ? Pourtant, vu la latitude
que laissait Napoléon à ses subordonnés, il y a tout lieu de croire
que c'est lui même qui a ordonné cette formation. Bugeaud d'ailleurs
écrira en 1833 au maréchal Soult :
Il est bien surprenant que Napoléon ait plusieurs fois commandé
lui-même cette ordonnance de combat, qui ne vaut même rien comme
manœuvre préparatoire, car on ne peut qu'avec de grandes difficultés
se former sur l'un des côtés du carré. La 1ere division attaque la ferme de la
Haie-Sainte, les 2e et 3e traversent le vallon et avancent avec
difficulté dans les terres détrempées. Au moment où les troupes
s'apprêtent à franchir le chemin, elles sont assaillies à la baïonnette
par l'infanterie de Picton, puis par la cavalerie lourde britannique.
Celle-ci taille dans les colonnes françaises, qui ne forment plus
qu'un troupeau désorganisé, et sur sa lancée, traverse le vallon
et vient jeter le désordre dans les pièces de la grande batterie.
Mais une brigade des cuirassiers de Milhaud, et le 4e régiment de
lanciers anéantissent pratiquement les dragons britanniques, dont
les débris sont recueillis par la cavalerie de Vandeleur. Pendant ce temps, à gauche de la route,
une brigade de cuirassiers, chargée par Ney
de nettoyer les abords de la Haie-Sainte, se fait ramener par la
brigade des Guards à cheval de Somerset. L'échec de l'attaque du 1er corps est complet.
Les Alliés ont fait 3000 prisonniers, mis hors combat une quinzaine
de pièces d'artillerie et pris deux aigles. Les 2e et 3e divisions sont absolument désorganisées.
La 1re et la 4e vont poursuivre, pendant des heures, un combat d'escarmouches
contre la ligne anglaise, en portant leurs efforts sur la ferme
de la Haie-Sainte d'une part, et sur le hameau de Smohain de l'autre,
tandis que de furieux combats se livrent autour du château d'Hougoumont.
Afin de soustraire ses troupes au feu de
l'artillerie française, Wellington les fait reculer de quelques
pas. Ney, voyant ce mouvement de repli, pense
que les Alliés entament la retraite. Il lance sur eux les cuirassiers
de Milhaud. Ceux-ci sont suivis par la cavalerie légère
de la Garde. Les cuirassiers escaladent le plateau, ce qu'on appelle
le "Mont-Saint-Jean". Le centre droit allié, objet de
cette attaque, s'est disposé en carrés. Les artilleurs anglais,
placés en avant, tirent une dernière décharge, puis courent se réfugier
dans les carrés. Les canons anglais sont aux mains des Français,
inutiles trophées, puisque les Français ne songent ni à les enclouer,
ni à les emporter. A plusieurs reprises, les cuirassiers vont
s'attaquer aux carrés, en vain. Napoléon estime le mouvement prématuré,
mais il le fait soutenir par le corps de cavalerie de Kellermann. Les grenadiers à cheval et les dragons de
la garde, du général Guyot suivent le mouvement : Napoléon n'a plus
de réserve de cavalerie. Pendant des heures ont lieu sur le plateau
des charges insensées, car elles ne sont pas combinées avec l'artillerie
et l'infanterie. Pendant qu'ont lieu ces grandes charges,
la Haie-Sainte finit
par être emportée. Les Français peuvent alors s'approcher encore
davantage de la ligne anglaise et harceler par un feu de tirailleurs
les troupes qui se trouvent en face d'eux Le 27th Enniskillen regiment of foot, exposé
au feu des tirailleurs et d'une batterie d'artillerie à cheval,
perd plus de la moitié de son effectif. C'est, pour Wellington,
le moment le plus critique de la bataille. Le centre de son armée
est à découvert. Il suffirait d'une dernière poussée des Français
pour percer la ligne, et remporter la victoire. Mais les troupes
françaises sont épuisées, à bout de forces. Et Napoléon, à cause
de la disposition du terrain, ne se rend pas compte de l'état exact
de la situation. D'ailleurs, son attention est attirée ailleurs. A quatre heure et demie, des coups de feu
et d'artillerie se font entendre sur la droite. D'après l'ensemble
des témoignages, Napoléon ignore s'il s'agit de
Grouchy ou de Blücher. Mais il ne tarde pas à être renseigné.
Ce sont les Prussiens qui le prennent en flanc. Ceux-ci ont marché
depuis Wavre, par d'affreux chemins étroits, encaissés, défoncés
par la boue. Ils sont stupéfaits de ne trouver aucune opposition
dans leur marche. Ils débouchent sur le champ de bataille sans avoir
vu un seul Français, alors que le plus petit peloton aurait pu retarder
une armée dans les défilés de la Lasne. Aucune force française dans
le bois de Paris, ni même au-delà. Domon Subervie, Lobau n'ont pas
exécuté les ordres de Napoléon. Mais les ont-ils reçus ? Et ces
ordres ont-ils réellement été donnés ? Ne serait-ce qu'à quatre heures et demie
que Napoléon aurait envoyé l'ordre à Grouchy
de marcher sur Saint-Lambert et d'attaquer
Bülow ? Grouchy a reçu l'ordre, mais
à sept heures seulement.... Combien de temps aurait-il fallu à un
officier pour joindre Grouchy ? C'est
Napoléon lui-même qui nous donne la réponse : deux heures ! En sortant du bois de Paris, les Prussiens
forment leur ligne parallèlement à la chaussée de Bruxelles et l'étendent
vers la droite, en vue de joindre la gauche de Wellington, et vers
la gauche, dans la direction du village de Plancenoit, afin de prendre
l'armée française à revers et de lui couper sa retraite. Napoléon dirige vers eux le 6e corps et
la Jeune Garde. Malgré leur infériorité numérique, les Français
parviennent à contenir Bülow. A l'extrême
droite, les troupes de la division Durutte redoublent d'efforts
pour empêcher la jonction des Prussiens et de la gauche alliée,
et ils s'emparent du hameau de Smohain. Mais pour Blücher, l'objectif est atteint
: donner de l'air à l'armée de Wellington, qui résiste jusqu'à la
limite aux furieuses attaques de Ney. Un peu avant sept heures, on aperçoit à
la droite de la première ligne française, dans la direction d'Ohain,
un feu d'artillerie et de mousqueterie. Est-ce Grouchy
qui prend les Alliés à revers ? Napoléon fait annoncer l'heureuse
nouvelle aux troupes sur toute la ligne, afin de stimuler leur ardeur.
Mais ce n'est pas Grouchy. C'est le corps
de Ziethen qui, parti de Bierges à 2 heures, était arrivé vers 6
heures en vue du champ de bataille. Sur les instances pressantes
du général Müffling, attaché prussien auprès de Wellington, le 1er
corps, au lieu d'aller rallier le corps de Bülow,
va renforcer la gauche anglaise à Smohain et la Papelotte. Ces nouvelles
forces prussiennes se joignent à l'armée de Wellington à l'angle
de jonction des deux lignes françaises. Napoléon jette alors ses dernières réserves
dans la bataille : les bataillons de la Moyenne Garde s'avancent,
gravissent la pente du plateau, renversent une ligne de tirailleurs,
mais sont accueillis par le feu le plus terrible de mousqueterie
et de mitraille. Un des bataillons de la Garde voit se dresser devant
lui un mur rouge : ce sont les Guards de Maitland qui étaient couchés
à terre et qui, se dressant au commandement de Wellington, font
feu pratiquement à bout portant. Cette attaque trop faible n'est soutenue
ni par la cavalerie, ni par l'artillerie, ni par les débris des
1er et 2e corps épuisés. Arrêtée par les Guards britanniques, prise
en flanc par les Néerlandais de Chassé et par le 52nd light Infantry,
la Moyenne Garde chancelle, recule. A la vue de l'échec de cette
troupe réputée invincible, l'armée, dont le moral a été affecté
lorsqu'elle s'est rendue compte que l'arrivée annoncée de
Grouchy n'était qu'un leurre, se débande. Tous, infanterie,
artillerie, cavalerie confondues, se précipitent sur la route, dans
l'espoir d'échapper à l'étreinte des troupes anglaises et prussiennes. La brigade de cavalerie légère anglaise
Vivian, ramenée de la gauche au moment de l'arrivée de Ziethen,
est lâchée dans la plaine et sabre les fuyards. Wellington, conscient de ce que le moment
est venu de transformer une défensive acharnée en victoire retentissante,
sous peine de laisser le profit politique de la bataille à ses alliés
prussiens, donne l'ordre à son armée d'avancer. La Vieille Garde, qui n'a pas encore donné
et qui est formée en carrés le long de la chaussée, contient pendant
quelque temps l'avance alliée. Mais dans la panique générale, elle
ne peut pas changer la face des choses. Quelques moments de résistance,
sans doute ornés de gros mots plutôt que de phrases héroïques, seront
grossis outre mesure, et fourniront matière à tableaux consolateurs.
Entraînée elle-même par ce mouvement inexplicable, la Garde suit,
mais en ordre, la marche des fuyards. A Plancenoit, où la lutte s'est poursuivie
avec un acharnement extraordinaire, deux bataillons de la Vieille
Garde ont tenu le village jusqu'à la tombée du jour, permettant
le repli des débris de Lobau. Les Prussiens de Ziethen, qui débouchent
du chemin d'Ohain, ont repoussé les Français devant eux ; ils ont
comme objectif le cabaret de la Belle-Alliance, bien visible de
loin. C'est là que Blücher rencontrera Wellington en le saluant
en français : "Quelle
affaire !" Les deux commandants en chef conviennent que la poursuite
sera confiée aux Prussiens, les troupes anglaises étant dans un
état d'épuisement qui leur interdit tout effort supplémentaire. Les débris de l'armée française s'engouffrent
le long de la chaussée vers Charleroi. Dans la petite ville de Genappe,
le pont sur la Dyle, passage obligé, forme un défilé étroit qui
ne fait qu'accroître le désordre. L'arrivée des troupes prussiennes
chasse les fugitifs qui avaient pensé pouvoir y passer la nuit.
Napoléon manque être pris au moment où il monte dans sa berline.
Il n'a que le temps de s'échapper, la voiture et tout ce qu'elle
contient tombe aux mains des Prussiens. L'armée française n'est
plus qu'un troupeau en déroute. "Waterloo,
écrira le professeur Bernard, est
un tournant dans l'histoire de la tactique. Si
l'artillerie britannique joue un rôle capital à Waterloo, les feux
de l'infanterie alliée sont également meurtriers. L'une et l'autre
désagrègent les formations d'attaque adverses beaucoup trop massives
; elles annoncent les changements que devrait subir la tactique
devant la puissance accrue de l'armement. Pour longtemps, le feu
posté va disqualifier la méthode du choc. (...) Waterloo inaugure
ainsi une ère de la tactique qui va durer 124 ans, 1815-1939 : celle
de la primauté de la défense sur l'attaque. " Napoléon, en cherchant par ses écrits à
masquer sa responsabilité dans la défaite, a empêché les militaires
français de tirer de la défaite les enseignements qui s'imposaient.
En 1900, le colonel Foch (futur maréchal) écrira : "Les
lauriers de la victoire flottent à la pointe des baïonnettes ennemies.
C'est là qu'il faut aller les prendre, les conquérir par une lutte
corps à corps, si on les veut". (Des principes de la Guerre.) De 1914 à 1917, ignorant les leçons de Waterloo,
l'armée française attaquera "à la pointe des baïonnettes". Charles de Gaulle, prisonnier en Allemagne, écrira dans ses carnets, en 1916 : "quelle erreur d'avoir voulu faire la guerre au XXe siècle d'après les formes de Napoléon..." A quel prix ? [1]
Cité par Foy dans sa relation écrite
le 23 juin 1815. |
||||
![]()