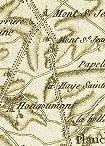![]()
|
Waterloo > Historiens > |
.
1815 - Waterloo de Henry Houssaye |
||||
|
||||
| Revue de Critique historique 1899, pages 506 - 515. |
||||
LA BATAILLE DE WATERLOO. 1815. Waterloo, par Henry Houssaye, de l'Académie française, Paris, Perrin et Compagnie, 1898, in-8° de 512 p. De toutes
les grandes batailles du premier Empire, celle de Waterloo restait
à décrire et à analyser. I. Au retour
de l'île d'Elbe, Napoléon n'osa pas recourir à une levée extraordinaire
pour doubler l'effectif de l'armée. Il se borna à rappeler les hommes
en congé de semestre et les « absents sans permission, » et encore
le décret d'appel préparé le 28 mars ne fut-il pas rendu public
avant le 9 avril. Cependant l'approche de la guerre et la crainte de l'invasion stimulèrent l'esprit militaire des départements de l'Est; des soldats retraités, des canonniers de la marine, des canonniers vétérans formèrent des corps spéciaux; on mobilisa les gendarmes, les douaniers ; on débarqua des fusiliers marins, et, à la fin de mai, l'Empereur avait porté l'armés active de 200.000 à 284.000 hommes et disposait d'une armée auxiliaire de 222.000 hommes. Les préparatifs de la campagne furent menés aussi rapidement qu'il était possible, étant données les difficultés à surmonter. Il y avait en effet peu d'argent dans les caisses publiques, peu de munitions dans les arsenaux, et la constitution des grands commandements et des états-majors fut laborieuse. Il fallut bien accepter les services de certains généraux qui s'étaient ralliée à la cause des Bourbons. Dans cette voie, il était impossible d'éviter l'arbitraire ; on fut impitoyable pour les uns, très indulgent pour les autres, et le corps d'officiers de l'armée impériale en ressentit un vrai malaise. Les commandants de corps d'armée étaient cependant bien choisis. Comme le dit M. Henry Houssaye : « Indépendamment de leurs qualités militaires innées, ils possédaient cette force : l'expérience, et cette vertu : la jeunesse. » (1815, p. 70.) Le plus âgé avait quarante-neuf ans, le plus jeune quarante. Quand Napoléon fut au courant des projets des alliés et put prévoir la quadruple invasion dont Paris était le suprême objectif, il se résolut à prendre hardiment l'offensive, à frapper un grand coup en Belgique, à attaquer Wellington et Blücher avant qu'ils eussent opéré leur jonction. Les ordres de concentration furent envoyés dans les premiers jours de juin et ils étaient merveilleusement rédigés ; le 14 juin, l'Empereur établit son quartier général à Beaumont; ses troupes (124.000 hommes) étaient réparties sur un rectangle mesurant huit lieues de large sur dix kilomètres de long. Les Anglo-Prussiens (190.000 hommes) étaient à cette date disséminés sur un front d'au moins trente-cinq lieues et sur une profondeur de quarante-huit kilomètres ; Wellington à Bruxelles, Blücher à Namur, ignoraient complètement la concentration opérée par l'armée française et la marche offensive commencée par l'Empereur. Avant d'avoir tiré un coup de fusil, la campagne stratégique paraissait terminée, et la victoire restait fidèle à l'aigle impériale. Le plan conçu par Napoléon était digne de son génie, les préparatifs de son exécution avaient complètement réussi. Aucun tacticien comme Jomini, l'archiduc Charles ou Gneisenau, aucun homme de guerre expérimenté n'eût prédit le désastre qui allait avoir pour théâtre les avant-plateaux de la forêt de Soignes. II. C'est dans
la matinée du 15 juin que les avant-gardes françaises franchirent
la frontière belge. Le départ du général de Bourmont causa un certain
trouble moral, et le retard du corps de Vandamme à se mettre en
mouvement rendit plus laborieux le passage de la Sambre, mais Charleroi
fut pris, et les troupes de Pirch, vivement poursuivies, se retirèrent
au delà de Fleurus. L'exécution de la première partie du plan de Napoléon, qui consistait à s'établir entre les deux armées ennemies pour les séparer, s'accomplissait plus lentement qu'on ne l'eût voulu, mais son succès n'était nullement compromis. L'empereur eut le tort de croire que les alliés, déconcertés par son mouvement offensif, allaient se replier sur leurs bases d'opérations respectives, les Anglais vers Ostende et Anvers, les Prussiens sur Liège et Maëstricht. Il ne voulut pas modifier ses instructions quand les masses de Blücher se déployèrent derrière Sombreffe (1). On sait la lutte acharnée qui se poursuivit à Saint-Amand et à Ligny, tandis que Ney, resté inactif toute la matinée du 16, se heurtait dans l'après-midi aux troupes de Wellington fortement établies et renforcées, et que Drouet d'Erlon, recevant heure par heure des ordres contradictoires de l'Empereur et de Ney, oscillait entre les zones d'action des deux batailles et ne coopérait ni à l'écrasement des Prussiens ni à l'enlèvement des Quatre-Bras. Les Souvenirs du général de Salle, commandant l'artillerie du premier corps (2), et la relation de Durutte ont permis de préciser les marches et contremarches de Drouet d'Erlon et de réfuter une assertion fantaisiste de Thiers au sujet du rappel de la division Durutte par le maréchal Ney. III. La retraite de l'armée prussienne rendait encore possible la réalisation du plan stratégique de Napoléon ; un corps d'armée suffisait pour parer à un retour offensif de Blücher, et l'on pouvait, avec tout le reste de l'armée, venir et bout de la ténacité des Anglo-Nassaviens. Mais il n'y avait plus de fautes à commettre et pas de temps à perdre. Or, on allait perdre encore du temps et commettre de lourdes fautes. La journée
du 17 fut mal employée. Sans doute, certains corps avaient besoin
de repos, mais d'autres n'avaient pas été engagés et étaient pleins
d'ardeur et d'entrain. Il fallait surtout ne pas perdre le contact
des Prussiens et s'assurer de la ligne de retraite qu'ils allaient
suivre. Napoléon crut a priori que leur armée se dirigeait
tout entière sur Namur, de même qu'il imagina qu'une simple arrière-garde
occupait les Quatre-Bras. Les deux hypothèses méritaient en tout
cas d'être contrôlées par des reconnaissances et au besoin des engagements
sérieux. L'Empereur se contenta de quelques rapports vagues et d'une
dépêche du général Pajol annonçant la prise d'un certain nombre
de traînards sur la route de Namur (1815, p. 200). Il donna au maréchal
Grouchy les corps de. Vandamme et de Gérard, la division Teste,
une nombreuse cavalerie et lui prescrivit de se mettre à la poursuite
de Blücher. Grouchy était venu aux ordres. L'Empereur le garda,
visita avec lui le champ de bataille de Ligny, se fit acclamer par
ses troupes au bivouac, causa longuement avec plusieurs généraux
de l'état de l'opinion à Paris, de Fouché, du Corps législatif.
Grouchy, qui, au départ de Fleurus, avait déjà demandé des ordres
et à qui Napoléon avait répondu avec humeur : « Je vous les donnerai
quand je le jugerai convenable, » n'osa insister et regagna
son quartier général. La cavalerie
de lord Uxbridge couvrit la retraite des Anglais. Napoléon la pourchassa
en personne et mit en branle tous les corps du prince de la Moskowa,
mais il était sept heures du soir quand on démasqua les forces de
Wellington rangées en bataille sur la crête du plateau dont la ferme
de Mont-Saint-Jean forme le centre. A l'aube, arriva une lettre de Grouchy portant que les Prussiens semblaient se retirer sur deux colonnes, l'une vers Liège, l'autre vers Wavre. L'Empereur laissa passer six heures avant de songer à compléter les renseignements de son lieutenant et à lui transmettre des instructions nouvelles. Il croyait que le pâle soleil, qui commençait à poindre après une nuit de pluie torrentielle, « allait éclairer la perte de l'armée anglaise » (6). Les péripéties du grand drame militaire qui se joua dans la journée du 18 n'ont besoin d'être ni rappelées ni résumées ; elles sont présentes à toutes les mémoires. L'unique objectif de Wellington était de résister sur ses positions jusqu'à l'entrée en ligne de l'armée prussienne. L'attaque tardive des Français (le premier coup de canon ne fut tiré qu'à onze heures et demie) augmenta ses chances de succès. Les charges folles de la cavalerie du maréchal Ney ne purent briser les carrés de l'infanterie anglaise, et après avoir pris par trois fois position sur le terrible plateau, les Français furent obligés de l'abandonner. L'entrée en ligne du corps de Bulow, bientôt suivi de celui de Zieten, précipite les événements. L'Empereur tente un effort désespéré et lance à l'assaut de Mont-Saint-Jean cinq bataillons de la moyenne garde.
Leur bouche, d'un seul cri, dit : « Vive I'Empereur!
» Son héroïsme fut inutile. Fusillée à bout portant, prise en écharpe par le général Chassé, cette troupe d'élite, écrasée, redescendit les pentes du plateau, et le cri: « la garde recule ! » retentit, ainsi que le dit M. H. Houssaye, comme le glas de l'armée et de son chef. On sentit que tout était fini, et c'était vrai. IV. Les historiens de Napoléon ont longuement débattu les causes de la défaite de Waterloo. Les uns, partant du principe que le vainqueur de Marengo et d'Austerlitz ne pouvait avoir commis de fautes graves, rejetaient sur son chef d'état-major et sur ses lieutenants la responsabilité du désastre ; d'autres incriminaient uniquement Grouchy; enfin quelques-uns prétendaient que l'Empereur n'avait plus conservé que l'apparence de son génie. Fatigué, malade, il était plongé « dans une espèce d'apathie » (7) et incapable d'exercer effectivement le commandement de son armée. Il y a une part de vérité dans ces opinions opposées, mais la principale cause de l'effondrement de la puissance militaire de Napoléon est une cause morale. M. Henry Houssaye ne le nie pas - " Les chefs sont hésitants, apathiques, sans zèle, sans initiative, sans entrain. Il semble qu'ils n'aient plus foi dans la fortune napoléonienne, qu'ils ne veuillent s'avancer qu'à pas comptés hors de la frontière.... La puissante machine de guerre qu'a construite Napoléon parait usée ou faussée. » (1815, p. 469-470.) Cette campagne de quatre jours n'a aucun rapport, du reste, avec les autres guerres de l'épopée impériale. Napoléon ne lutte pas seulement contre des puissances ennemies : il lutte contre la destinée, cette force des choses qui est une loi de Dieu. Il commande à ses soldats et non plus à son peuple. Il a conscience que son pouvoir ne résistera pas à une défaite. Son armée, qui l'a replacé sur le trône, ne lui inspire plus la même confiance qu'autrefois ; il n'a qu'une estime relative pour des généraux et des officiers ayant forfait à l'honneur en violant leurs serments. Sans doute le courage ne leur fera pas défaut dans la bataille, mais des préoccupations, des arrière-pensées les hanteront jusqu'au milieu de la mêlée. Dans la matinée du 17, alors qu'il n'y avait pas une minute à perdre pour précipiter la retraite des Prussiens et tirer parti de la victoire de Ligny, l'Empereur passait deux heures à visiter les bivouacs pour se griser encore du bruit des acclamations, et ne pouvait s'empêcher d'entretenir ses généraux de l'état de l'opinion à Paris, des intentions du Corps législatif, de l'attitude de Fouché. Le plan
de Napoléon était simple, logique, admirablement conçu dans son
ensemble. Le colonel Chesney admet lui-même que « la balance
de la stratégie penchait du côté des Français. » Les fautes
qui entravèrent son exécution furent nombreuses et s'expliquent
plus aisément par la philosophie que par l'art militaire. Faut-il alors s'étonner que Ney, Drouet d'Erlon, Grouchy, se soient montrés timides, hésitants, dans les journées des 16, 17 et 18 juin ? Autrefois l'Empereur était partout, voyait tout, surveillait tout; pendant ces mémorables journées, il chevauchait peu, voyait mal, était insuffisamment renseigné. Ses ordres, tardivement transmis et mal précisés par le major général, jetaient l'indécision dans l'esprit de ceux qui les recevaient. On attendait des instructions complémentaires qui ne venaient pas ou n'expliquaient rien, et aucun commandant de corps d'armée n'osait prendre sur lui d'engager une action ou d'effectuer un mouvement à la fois hardi et raisonné que l'Empereur n'avait pas prévu. Tout autre
est l'idée que se font de leur rôle les lieutenants de Wellington
et de Blücher. Dans la journée du 15, le jeune prince Bernard de
Saxe-Weimar, prévenu fortuitement du passage de la Sambre par les
Français, occupe de sa propre autorité, avec quatre bataillons de
Nassau, la forte position stratégique des Quatre-Bras, où il tint
en échec l'avant-garde de Ney. Blücher
avait disparu, on le croyait mort ou prisonnier, quand Gneisenau
donna l'ordre de battre en retraite sur Tilly et Wavre, et cette
initiative eut le résultat décisif que l'on sait. Livrés à eux-mêmes, les lieutenants de Napoléon n'étaient cependant pas dépourvus de qualités militaires et d'esprit d'initiative. Le maréchal Grouchy, sur qui l'on s'acharna si longtemps à faire retomber toutes les responsabilités du désastre, allait en donner une preuve éclatante. Dans la matinée du 19, le lendemain de Waterloo, il inflige un sanglant échec à Thielmann, puis, informé de l'effondrement de l'armée impériale, il prend avec sang-froid ses dispositions stratégiques, se retire dans le plus grand ordre, faisant face aux corps de Thielmann et de Pirch, quand ils le serrent de trop près, résiste plusieurs heures dans Namur, et le 21 son armée tout entière était rassemblée sous le canon de Givet (8). M. Henry Houssaye affirme, assez témérairement, étant donnés les documents cités au cours de son onvrage, que jamais Napoléon n'exerça plus effectivement le commandement qu'à Waterloo, et que jamais son action ne fut plus directe. La vérité est que, pendant si longtemps favorisé par la fortune, il avait joué le rôle de " sergent de bataille » condamné par Maurice de Saxe. Ce rôle, il ne le joua plus ou le joua mal du 16 au 18 juin ; ses lieutenants crurent qu'il le remplissait toujours, et ce fut là l'unique grief qui peut leur être imputé. Dans la
Guerre et la Paix, Tolstoï a caractérisé la manière dont le
général Bagration exerçait son haut commandement en 1805 : Le grand écrivain russe a quelque peu rétréci la mission et les devoirs d'un chef d'armée, mais Napoléon ne les avait-il pas exagérés et, par suite, légèrement faussés ? L'Empereur avait eu le sourire de la fortune dans la plénitude de son génie. La fortune s'était lassée, et le génie était à son déclin au lendemain de Ligny et au soir de Waterloo. ROGER LAMBELIN.
Notes. (1.) Wagner, IV, 21. (Retour au texte.) (2.) Nouvelle Revue, 13 janvier 1895. (Retour au texte.) (3.) Archives de la guerre. Armée du Nord. Au maréchal Grouchy, "dicté par l'empereur au grand maréchal en l'absence du major général". (Retour au texte.) (4.) Archives de la guerre. Fragment des Mémoires de Molitor. (Retour au texte.) (5.) Campagne de 1815, par Gourgaud, p. 82. (Retour au texte.) (6.) Napoléon, Mémoires, p. 122. (Retour au texte.) (7.) Études sur Napoléon, par le lieutenant-colonel de Baudus, aide de camp du maréchal Bessières et du maréchal Soult. (Retour au texte.) (8.) Dans ses Conférences sur Waterloo, le colonel Chesney a qualifié, avec un peu d'exagération toutefois, cette marche de Grouchy de Wavre à Givet : une des plus étonnantes retraites de l'histoire militaire moderne. (Retour au texte.) (9.) La Guerre et la Paix. Paris, Hachette, 1881. T. 1, p. 202-203. (Retour au texte.)
|
![]()