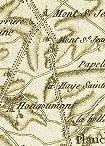|
|
|
Dernière modification le 14 décembre 2006.
Esmangart
Le
Moniteur (“seul journal officiel”)
publie le 12 vendémiaire an 10 (4 octobre 1801)
l’analyse suivante d’un ouvrage consacré aux colonies françaises. On y
remarque la
proposition de
revenir à la vieille pratique de la traite des nègres, abolie en France
en même temps
que l’esclavage par
la loi du 16 pluviôse an 2 (4 février 1794).
De
là à rétablir l’esclavage...
?!
Des colonies françaises, et en
particulier de l’île de Saint-Domingue, par Charles Esmangart, ancien
officier de marine. A
Paris, chez H. Agasse*, imprimeur-libraire, rue des Poitevins, n°
18, an 10. Tel
est le titre d’une brochure que vient de publier le même auteur
à qui l’on doit un écrit sur la marine française, lequel obtint,
au commencement de l’an 9, un succès mérité auprès de tous les bons
esprits qui se sont occupés de cette branche essentielle de l’administration
publique. Ce
nouvel ouvrage nous paraît fait pour produire une vive sensation,
soit par l’importance du sujet, soit par la manière dont il est
traité : la modération avec laquelle s’exprime le citoyen Charles
Esmangart, prouve un homme pénétré de la vérité de ce qu’il avance,
et quelqu’éloigné qu’on pût être de ses idées, il est difficile
de ne pas les adopter après qu’il les a présentées avec tant de
clarté et de précision, et lorsque c’est dans une longue expérience
qu’il puise la principale force de ses raisonnements. Son but est
de détourner le gouvernement de tout projet d’établissements nouveaux
: il veut au contraire que la France s’occupe des moyens de rendre
à ses possessions actuelles l’éclat dont la guerre leur a fait perdre
une partie, mais dont elles conservent toujours la source. Enfin,
il pense, et il démontre avec évidence que de toutes les colonies
qui nous restent, c’est surtout l’île de Saint-Domingue qui mérite
la sollicitude et les efforts du gouvernement.
Nous allons donner une analyse rapide de cet intéressant
ouvrage. (...) Nous
suivons l’auteur à Saint-Domingue, et nous rappelant avec lui que
cette superbe colonie, la première des Antilles pour la fertilité,
pour la population et la richesse, contenait, en 1789, cinq cent
vingt mille individus, et faisait pour deux cent cinquante millions
d’exportation annuelle ; nous cherchons la cause de cet accroissement
prodigieux qui fut l’ouvrage d’un siècle ; nous la trouvons dans
l’amélioration des cultures, dans l’augmentation et le renouvellement
de la population par la traite, dans le traitement plus doux et
plus humains que les colons français exerçaient envers les nègres,
circonstance sur laquelle se sont accordés tous les voyageurs et
les écrivains de toutes les nations. Mais les malheurs de la révolution
et les désastres de la guerre, ont détruit en partie ce brillant
édifice. Est-il possible d’en réparer les ruines ? C’est ce qu’affirme
le citoyen Esmangart ; et si quelque chose peut sembler digne d’estime,
c’est la bonne foi d’un colon qui pense et qui prouve que l’émancipation
des nègres, après avoir, par son imprudente précipitation, amené
tant de calamités, n’est point un obstacle au rétablissement de
la colonie, et qu’il serait aussi injuste qu’impolitique de revenir
sur le principe de cette émancipation. Pour
maintenir la subordination, si nécessaire parmi les différentes
classes d’habitants, surtout aujourd’hui que l’affranchissement
des nègres et l’habitude de l’indiscipline les ont rendus plus difficiles
à contenir, l’auteur fait sentir la nécessité d’établir un gouvernement
très fort, et au moment même où il publiait ses idées à cet égard
et rappelait l’ancienne administration des colonies, il se rencontrait
avec le système que le gouvernement français avait adopté pour la
Guadeloupe et qu’il vient de faire connaître. Parmi les moyens qu’il
conseille, un des premiers, selon lui, doit être de rétablir les
habitants dans leurs droits de propriété, et de protéger leur rentrée
sur leurs plantations. (...) Après
avoir retracé le tableau de l’ancienne prospérité de Saint-Domingue,
et indiqué les mesures nécessaires pour la faire revivre, le citoyen
Charles Esmangart examine les avantages que promet à la France la
partie de l’île qui appartenait à l’Espagne, et qui nous a été cédée
par cette puissance. (...) Les
avantages futurs qui résulteront de cette nouvelle possession dépendent
des progrès de la culture et de l’accroissement de la population.
Ces deux causes inséparables, comme leurs effets, seront infaillibles.
Mais quel est le moyen d’augmenter la population ? Il en est un
que l’auteur regarde comme le plus efficace, et qui, fondé sur les
bases qu’il lui indique, ne serait contraire ni à la justice, ni
à l’humanité. Ce moyen, c’est la traite, pratiquée par tous les
peuples de l’Europe, et à laquelle la France n’a aucune raison de
renoncer. Il propose donc un engagement de sept années, au bout
desquelles les nègres nouvellement achetés, auraient, par leurs
travaux, indemnisé les cultivateurs de toutes leurs avances, et
seraient libres de rester alors sur les habitations de leurs premiers
maîtres, ou d’aller employer pour d’autres leurs bras et la jouissance
de leur personne. Pour quiconque connaît le climat des colonies,
et est bien convaincu qu’elles ne seront jamais peuplées utilement
que par des ouvriers nègres, les raisonnements du citoyen Esmangart
sont de toute évidence, et ses réponses à toutes les objections,
d’une sensibilité feinte ou malentendue, paraîtront l’effet d’une
philanthropie mieux éclairée, qui, au lieu de l’état continuel de
guerre et de l’esclavage éternel auquel les nègres sont condamnés
dans leur pays, ou dans les colonies étrangères, leur présente,
dans nos possessions, un prompt acheminement à la civilisation et
à la liberté. (...) Cette brochure, plus substantielle que bien des volumes, honore également le bon esprit, le talent et le zèle du citoyen Charles Esmangart. |