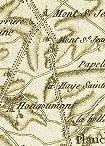| |
Berthier
(Alexandre), le plus intime des confidents de Napoléon, dont
il avait été le chef d'état-major pendant l'immortelle
campagne d'Italie, en 1796, et qui, depuis, lé décora
successivement des titres de maréchal, de grand-veneur, de
vice-connétable, de prince souverain de Neuchâtel et
Valengrin de prince de Wagram, etc., etc., naquit en1753 à
Versailles, d’un officier au corps des ingénieurs-géographes,
et mourut en 1815, à Bamberg au château du prince de
Bavière, son beau-père.
Il occupe une place distinguée dans l'histoire contemporaine,
l'homme qui un moment remplaça Bonaparte dans le commandement
en chef de l'armée d'Italie, qui acheva la conquête
de Rome, qui organisa la république de Milan, et qui attacha
son nom à d'importants traités, comme la capitulation
d'Ulm (voy.), le traité de Munich (1806), la convention de
Koenigsberg, etc.; car cet homme avait la pensée du maître,
et son talent c'était de la mettre en application.
Destiné par son père au corps des ingénieurs,
il y entra après en avoir fait les études spéciales,
mais bientôt il obtint une compagnie dans les dragons de Lorraine,
d'où il passa, comme officier d'état-major, à
l'armée expéditionnaire d'Amérique, sous les
ordres du général Rochambeau. Devenu colonel aide-major-général
pendant là guerre de l'indépendance, où il
s'était vaillamment conduit, il fut, après son retour
nommé, en 1789, major-général de la garde nationale
de Versailles, ville où il s'acquit des droits à l'estime
dés bons citoyens par la modération et là fermeté
qu'il mit dans ses fonctions, surtout à l'occasion des troubles
excités par la nouvelle de la fuite des tantes du roi pour
l'Italie.
Vers la fin de 1791 il fut envoyé à Metz en qualité
d'adjudant-général, et bientôt après
le maréchal Luckner se l'attacha comme chef d'état-major.
Employé dans l'ouest, il y fit son devoir contre l'insurrection
avec la même vigueur, et il échappa ainsi aux accusations
que motivait sa conduite à l'égard des démagogues
à Versailles
Le 13 juin 1793 il eut trois chevaux tués sous lui en défendant
Saumur contre l'armée royaliste; alors il était chef
d'état-major du maréchal Biron. Deux ans après
il fut promu au grade de général divisionnaire et
choisi pour chef d'état-major par le général
Bonaparte, lorsqu'il prit le commandement de l'armée d'Italie.
C'est la belle époque de la vie militaire de Berthier, qui
seconda dignement son chef et eut une glorieuse part aux combats
de Millésime, Ceva, Mondovi, au passage du pont de Lodi,
à la bataille de Rivoli. Il avait mérité ainsi
l'honneur d'apporter au Directoire le traité de Campo-Formio.
Ce fut au mois de décembre 1797 qu'il remplaça dans
le commandement en chef Bonaparte, forcé par la difficulté
des négociations à se rendre au congrès de
Rastadt. Berthier ne fit que continuer l'exécution des desseins
de son général en chef.
Il suivit en Égypte le héros qui dès ce temps
l'associait, pour ainsi dire, à son brillant avenir, et auquel
il était lui-même attaché par affection autant
que par devoir. De retour avec lui, il devint ministre de la guerre
quand son chef et son ami fut nommé premier consul ; mais
il ne resta dans ce poste que jusqu'au 2 avril 1800, époque
à laquelle il retourna en Italie avec le titre de général
en chef. Il ouvrit ainsi la campagne de Marengo, dont la gloire
reste à Napoléon. On ne peut pas séparer davantage
le reste de ses services militaires de l'histoire des campagnes
de l'empereur.
Berthier fut fait maréchal le 19 mai 1804; les autres dignités
plurent sur lui à de courts intervalles, et ce fut pour le
grandir encore que l'empereur lui fit épouser la fille du
duc Guillaume de Bavière-Birkenfeld , cousin du roi de Bavière,
union dont il devait rester à son auteur un souvenir plus
digne que ne le donneraient à croire les prétendues
réminiscences de l'exilé de Sainte-Hélène,
enregistrées dans le Mémorial (tome V, pag. 72 et
suiv.). Il y a dans l'honneur des familles quelque chose de plus
sacré que les paroles même d'un monarque déchu
; et les invectives qu'à l'égard de cette union l'on
s'est cru autorisé à livrer au public, sous la forme
de révélations historiques, sont dignes tout au plus
de figurer dans un pamphlet.
A la Restauration de 1814, le prince de Wagram ne fut pas des derniers
à signer l'acte de déchéance de Napoléon.
Ce fut lui qui, à la tête des maréchaux, prononça
l'allocution obligée à Louis XVIII, dans le château
de Compiègne. Compris dans la formation de la chambre des
pairs, il inspira assez de confiance au roi pour que celui -ci le
plaçât à la tête d'une des deux compagnies
qu'il ajouta à la première formation de ses gardes-du-corps.
On sait que l'autre porta le nom du duc de Raguse. La suite a prouvé
que c'était là une mesure habile, car ces deux maréchaux
n'ont point failli à la foi jurée envers la Restauration.
La principauté de Neufchâtel, dont Berthier avait été
investi, à titre de fief, par Napoléon, à qui
la Prusse l'avait cédée par la convention de Vienne
du 3 décembre 1805, rentra en la possession de Frédéric-Guillaume
III dès le 25 janvier 1814; cette reprise fut sanctionnée
par un article additionnel au traité de Paris du 30 mai 1814;
Berthier y adhéra par son acte de renonciation, signé
le 2 juillet suivant, moyennant une pension de 25,000 francs réversible
par moitié sur sa veuve; pension que le roi de Prusse consentit
à lui payer.
Le prince de Wagram ne jouit pas longtemps des bonnes grâces
de Louis XVIII - une lettre qu'il avait reçue de l'île
d'Elbe lui suscita des tracasseries contre lesquelles il sut opposer
plus de courage qu'on n'en avait à la cour de Napoléon
; pourtant au retour de celui-ci il ne céda pas à
l'occasion de se venger. Il prit le parti de se retirer à
Bamberg, et sa mort même n'a pas trouvé grâce
devant l'esprit de parti pour une résolution aussi loyale.
On a prétendu que le suicide qui termina ses jours n'aurait
été qu'un dernier acte du vertige que décelait,
dans les derniers temps, son état mental. Mais, ne serait-il
pas plus juste de dire qu'après avoir cédé
une première fois à l'empire des circonstances en
sacrifiant à ses devoirs politiques les engagements de l'affection
et de la reconnaissance, Berthier ne voulut pas dévorer,
comme tant d'autres, l’humiliation d'un nouveau parjure, en répudiant
la foi jurée à la Charte de 1814, qui garantissait
l'indépendance et la liberté de la France.
Il existe quelques pièces de monnaie frappées à
l'effigie de Berthier, comme prince souverain de Neufchâtel;
on en a vu dans le médailler d'un savant amateur. Nous ne
sachions pas qu'il ait jamais composé de vers, quoiqu'on
l'ait représenté comme un Céladon; mais il
a publié les ouvrages suivants : Relation de la bataille
de Marengo, Paris, an XIV, in-8° et in-4° avec cartes
; Relation des campagnes du général Bonaparte
en Égypte et en Syrie, Paris, 1800, in-8°'.
On a imprimé à Paris, en 1826, les Mémoires
d'Alexandre Berthier, prince de Neufchâtel et de Wagram,
1 vol. in-8°.
|
|
|
|
![]()

![]()