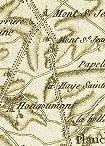![]()
|
Annuaire 1789-1815 > France > Société > |
.
Vivandières |
| Vivandière, subs. fém. Femme autorisée à suivre un corps de troupe pour y exercer, en détail, le même métier que le vivandier. Dans les anciennes guerres, c'étaient des hommes, des entrepreneurs militaires, des brandeviniers, comme on les appelait, qui s'attachaient aux régiments et marchaient avec eux. Sans doute des femmes de soldats ont de tout temps vendu des vivres, mais ce n'était pas, dans le principe, une profession avouée, soumise à des règles, comme l'est devenue l'institution des cantinières et vivandières. L'ordonnance du 12 mai 1714 défendait aux femmes de vivandiers de faire commerce d'aucune toile peinte ou étoffe venant des Indes et de la Chine ou du Levant, ou faite à l'imitation de ces fabriques étrangères ; elle leur défendait également de s'en vêtir, sous peine de confiscation et amende d'un tiers de la valeur des objets ; celle du 25 avril 1717 ajoute que les Vivandières convaincues de fraude à cet égard seront condamnées au fouet. Il parait que ce n'était pas encore assez, et que quelques-unes avaient bravement affronté la peine, car l'ordonnance du 1er mars 1768 ne permit plus aux corps de conserver dans leurs garnisons les vivandières. Cette décision tenait peut-être aussi à ce qu'il y avait dans les places fortes des cantines autorisées, jouissant de certains privilèges, soumises à certains droits au profit des officiers de place ; cette concurrence de vivandières particulières eut fait tort aux cantines stables, et eût été d'ailleurs un moyen de contrebande. Avec la révolution, les vivandières perdirent en quelque sorte leur nom, parce que la loi ou les décisions ministérielles ne voulaient plus les considérer que comme blanchisseuses ;c'était à ce titre qu'elles avaient brevet, qu'elles portaient médailles, qu'elles jouissaient de certaines faveurs, telles que le logement dans les casernes, la fourniture de pain, la fourniture de fourrages, parce que la possession d'un cheval leur était permise. Le décret du 50 avril 1795, qui congédia des armées les femmes inutiles, en excepta les vivandières, qui devaient recevoir une marque distinctive ; mais si elles ne faisaient aucun commerce de vivres ou de boissons, elles étaient congédiées, leur marque retirée et remise au général divisionnaire. Un arrêté du 7 thermidor an huit fixe le choix des vvandières et leur nombre à quatre par bataillon, deux par escadron, mais il peut y en avoir à la suite du quartier général de chaque division autant qu'il y a de corps dans cette division. Elles n'ont droit à aucune solde ni distribution ; cependant les inspecteurs aux revues n'en doivent pas moins se faire présenter un état indicatif de leur âge, profession et signalement. On leur délivre une carte de sûreté pour circuler dans l'étendue de l'armée ou de la division. D'après le décret du 28 messidor an douze, les vivandières ne sont admises dans les hôpitaux qu'en temps de guerre. L'ordonnance du 2 novembre 1835 a réglé leur service et leurs devoirs, comme celle du 18 avril de l'année précédente fixa le nombre qui devait en être affecté à chaque corps. Il fut décidé, le 10 septembre 1859, qu'aucune femme de sous-officier ne pourrait désormais exercer la profession de vivandière dans le corps dont son mari ferait partie. Il y avait en effet, sous le rapport de la discipline, plus d'un inconvénient à ce qu'un sergent servît à boire aux soldats. Aujourd'hui l'institution des vivandières est fixe et régulière ; aux haillons, au costume bigarré des vieilles femmes de troupe, a généralement succédé un vêlement coquet : un pantalon rouge, un caraco bleu, un jupon court, un baril d'uniforme, des bottines et un petit chapeau ciré à la marinière. — Les auteurs qui donnent quelques détails sur ce sujet sont : Furetière, le général Lecouturier (1825) et le général Preval (1827). |
|
|
![]()