![]()
|
|
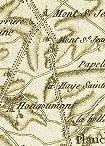
|
|
|
Annuaire 1789-1815 > France > Armée > |
.
Recrue |
||||
|
||||
| Faut-il dire « un
recrue » ou « une recrue » ? Le
général Bardin s’est longuement étendu sur le sujet, dans son « Dictionnaire
de l’Armée de Terre » : |
| RECRUE, ou BISOGNE suivant Roquefort, ou CONSCRIT comme disaient les soldats, ou JEUNE SOLDAT comme l'a mis en vogue le ministre Gouvion, ou RECREUE comme l'écrivait JOINVILLE au temps de Saint-Louis, ou SOLDAT DE RECRUE comme l'appelaient Bombelles (1746, A), et, à son instar, les règlements du temps. - Le mot Recrue est d'une orthographe équivoque et d'un genre douteux. Quelques-uns, l'employant au masculin , l'ont écrit RECRU, ce qui était plus rationnel que le mode que l'Académie a adopté. L'ordonnance de 1766 (ler janvier) et l'arrêté de l’an douze (19 vendémiaire) le faisaient masculin, en lui conservant l’e muet qui le termine; c'était la syncope du terme jusque-là en usage, HOMME DE RECRUE, terme qu'employait encore l’ordonnance de 1855 (2 novembre, art. 96). L'ordonnance de 1823 (19 mars, art. 5 et 526) le faisait féminin. - Pour remédier aux incertitudes, aux contradictions, convenons qu'une RECRUE est une levée ; ainsi le comprenait Joinville, de là les locutions aller, envoyer en recrue ; qu'un RECRUE est un homme, de là l'emploi du terme, sous cette forme, depuis 1766, ainsi que dans l'ordonnance de 1818 (13 mai) et dans l'instruction de 1822 (3 juillet, art. 166). - Le caprice du soldat a jeté ce mot, comme tant d'autres, dans la langue militaire ; il était d'abord analogue au participe accru , et venait du latin recrudescere, ou du verbe recroître suivant Leduchat. Racine, dans une lettre qu'il écrivait à son fils en 1691 (15 novembre) , blâmait, comme barbare, le verbe recruter. Le substantif Recrue répond aux termes latins junior et tyro et à l'italien tirone qu'on a traduit par tiron, tyron. - Il a produit, sous forme estropiée, les expressions recrutement, RECRUTEUR, RECRUTER; ce dernier terme n'était pas du bel usage du temps de Furetière, comme il le témoigne. - Audouin (t. II p.32 supposait que cette expression provenait de recrant, recreus ; d'autres, avec moins d'invraisemblance, la tiraient du latin recrudescere, renouveler. Ménage rapportait ce mot aux anciens usages de l'armée hollandaise, et prenait l'adjectif recru dans le sens d'accru et comme l'opposé de décru ; mais il vient du verbe italien reclutare, reclutato d'où le substantif féminin recluta. Ce terme, emprunté à la composition des milices de l'Italie ne signifiait d'abord que l'action du recrutement à prix d'argent, que l'appel adressé à des volontaires. L'usage du terme se répandait surtout sous Louis treize ; il figure dans l'ordonnance de 1628 (18 août). Par synecdoque, il a ensuite désigné, non plus l'action de lever des troupes, de grossir des cadres, mais l'homme enrôlé ; et, de nos jours , la langue a admis cette acception, toute corrompue et mal imaginée que fût la location. - Les Romains employaient, dans le sens de Recrue ou d'étudiant en tactique, les substantifs tyro, tyrunculus, dont nos ancêtres eussent mieux fait d'approprier aux troupes la traduction tyron. Les Espagnols se servaient de l'expression bisono, dont le vieux français avait fait bisoigne bisogne, qu'on retrouve dans Brantôme (1600, A). On disait, jadis, s'enforçair de gens, dans le sens de faire des recrues. - Bussy Rabutin raconte, dans ses Mémoires secrets, que deux gentilshommes, qu'il nomme et qui vivaient de filouteries, ayant su qu'il avait touché douze mille livres pour faire les recrues de son régiment, c'est-à-dire les levées ( car alors, homme et recrue n'étaient pas encore synonymes), parvinrent à lui voler une partie de cette somme. - Dans la bouche du soldat et dans quelques règlements (car la législation s'est pliée à admettre le parler défectueux du soldat) recrue signifie homme de nouvelle levée dont la taille a été constatée sous la toise, dont le signalement été dressé; soldat faisant son noviciat et non encore aguerri, fantassin qui n'est pas encore entré à l'école de bataillon. - Les miliciens de Louis Quatorze étaient des recrues forcés. Ce prince, dans ses dernières guerres, ne sachant plus comment avoir des recrues, faisait poursuivre et traquer hommes, à la manière de la presse anglaise. –La guerre de 1741 avait épuisé les moyens de recrutement et les recrues. - Les derniers recrues de la France impériale n'avaient que le souffle. Bombelles (1746) et ses contemporains empruntaient à la langue de la vénerie le terme ameuter les hommes de recrue ; c’était les plier au joug, les assouplir à la vie de soldat. Les capitaines, étant autrefois propriétaires de leurs compagnies, étaient chargés d’en faire chercher et d’en trouver les recrues. L’ordonnance de 1762 (10 déc.) les dispensa de ce soin : mais chaque officier en semestre était tenu de faire, pour le régiment, deux hommes. |
|
|
||||
|
