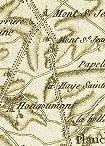![]()
|
Annuaire 1789-1815 > France > Société > |
.
Traité de Commerce franco-anglais de 1786 |
||||
|
||||
Le
traité de commerce entre la France et l’Angleterre, prévu dans le
traité de paix de 1783, fut signé le 26 septembre 1786. Il était
basé sur la liberté des échanges. L’économie française supporta
mal la concurrence anglaise : “Dans
la première année qui suivit le traité en 1787, les Anglais introduisirent
en France pour plus de 30 millions d’objets manufacturés. Cette
quantité énorme excédait de beaucoup la consommation ordinaire.
Ils ont été forcés de vendre à 30, 40, pour 100 de perte. Ces ventes
à prix avilis ont été très préjudiciables à nos manufactures, qui
n’ont pu soutenir une concurrence aussi inégale. Elles ont alors
réclamé avec raison contre un traité qui avait excité de semblables
spéculations ; spéculations qui ne sont pas restées impunies, car
en 1787 et 1788 il y a eu dans les fabriques d’Angleterre pour plus
de 100 millions de faillites. (M. Boislandry à l’Assemblée nationale
le 30 novembre 1790, Moniteur 1er décembre 1790.) D’après
Bertrand de Jouvenel*,
“la cause véritable du succès
anglais est la supériorité de mérite de leurs industriels. Ils sont très en avance sur nous
au point de vue technique et ils se fient à leur esprit d’initiative
plus qu’à des mesures de monopole”. Le
même auteur estime : “Nos
fabricants routiniers se révélèrent incapables de supporter la concurrence
anglaise et les pertes qu’ils subirent alors excitèrent dans le
Tiers-Etat une anglophobie qui se manifestera durant toutes les
guerres de la Révolution et de l’Empire.”
*Bertrand
de Jouvenel, Napoléon et l’économie dirigée, le Blocus continental,
1942. |
| Le Moniteur universel, mardi 1er décembre 1789 : |
||||
| De Roubaix. Tous les habitants, hommes et femmes de ce bourg, viennent de signer un acte civique, par lequel il s'engagent de ne plus s'habiller qu'avec des étoffes de France. Puisse ce bel exemple de patriotisme être imité dans toutes les provinces, dans tous les cantons du royaume ! Une telle résolution ramènerait l'activité et l'industrie dans nos fabriques. Avant le traité de commerce entre la France et l'Angleterre, il y avait à Roubaix et dans son district trois mille métiers en activité. ; aujourd'hui il est démontré par l'aperçu que vient de faire, il y a huit jours, le bureau de fabrique, qu'il n'y en a plus que mille à onze cents. D'après cela, on peut juger de la misère extrême qu'éprouvent tant d'ouvriers, presque tous pères de famille. (.) |
| Le Citoyen français du 18 vendémiaire an 10 : |
||||
| Paris, 17 vendémiaire. Quelques journaux ont dit que, dans la séance du 1er février 1793, ce fut sur la proposition de Brissot que la Convention nationale déclara la guerre à l’Angleterre. J’étais présent à cette séance, dit aujourd'hui l’un de nos plus estimables confrères dans sa feuille de Rouen ; il est impossible de peindre l’enthousiasme qu’excita en cette occasion le rapport fait par Brissot au nom du Comité diplomatique. On fit depuis à l’infortuné Brissot un crime d’avoir été l’une des causes de la guerre contre la nation britannique, comme si une guerre qui mettait fin au désastreux traité de commerce fait par le ministre Vergennes n’eût pas été un bienfait national.” |
|
|
![]()