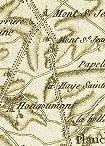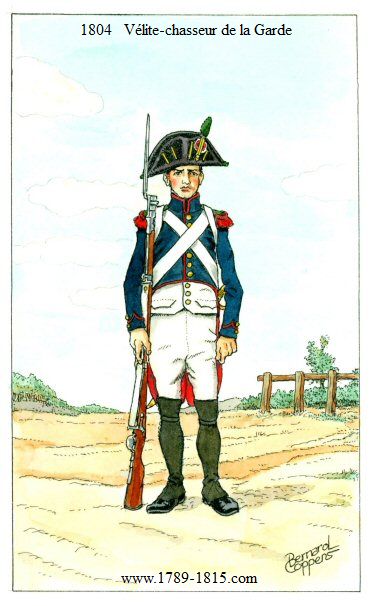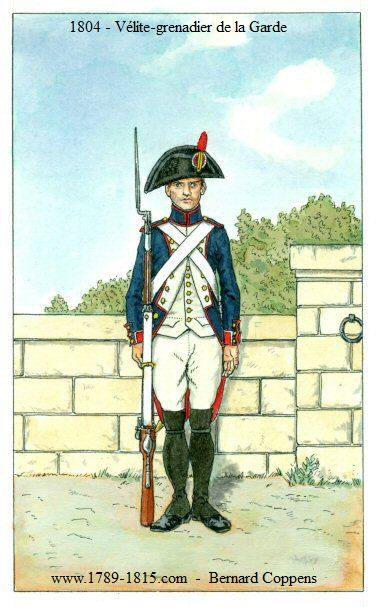![]()
|
Annuaire 1789-1815 > Armées > France > Garde |
.
Vélites de la Garde |
||||
|
||||
| Les vélites
de la garde furent créés par l'arrêté du
30 nivôse an XII (21 janvier 1804), intitulé « pour
la formation de deux corps de vélites faisant partie de la
Garde ». Chacun de ces corps devait être de
800 hommes au moins (soit un bataillon), et être attaché
l’un aux grenadiers à pied, et l’autre aux chasseurs à
pied. Pour cette raison la moitié des conscrits devait mesurer
au moins 5 pieds 4 pouces (1 m 733), et l'autre moitié, celle
destinée au corps des chasseurs à pied, 5 pieds 2 pouces. |
||||
Ils devaient
être composés de jeunes gens pris parmi les conscrits
de la réserve des ans IX à XII, soit qu'ils se soient
portés volontaires pour en faire partie, soit qu'ils aient
été désignés par les préfets
parmi les conscrits de la réserve. |
||||
A l'instigation
de son frère, qui était alors secrétaire général
de la préfecture du département de la Haute-Loire,
J.-B. Barrès demande et obtient son admission parmi les vélites. Arrivés
à Paris le 7 juillet 1804 (19 messidor an XII) les 25 aspirants
vélites du département de la Haute-Loire, parmi lesquels
se trouvait J.-B. Barrès, sont conduits à l’École
militaire pour y être incorporés dans la garde impériale.
Après être passés sous la toise, ils sont répartis
dans les vélites grenadiers ou dans les vélites chasseurs.
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
Peu
de renseignements nous sont parvenus sur l'uniforme porté
par les vélites de la Garde. Nous avons vu la description
que donne Barrès du surtout qu'il reçut lors de son
incorporation dans le corps. C'était là un effet de
seconde tenue, et Barrès raconte que les vélites reçurent
leur uniforme de grande tenue à l'occasion du sacre de l'Empereur,
mais il n'en donne pas la description. On ne distingue pas, sur le dessin de Boisselier, de passepoil rouge sur les revers. J'ai néanmoins cru devoir rétablir ce détail sur mon dessin, pour la raison suivante: on sait que les vélites grenadiers et les vélites chasseurs furent réunis en 1805 en un éphémère régiment de vélites de la garde, lequel devint, en 1806, 2e régiment de fusiliers, rattaché au corps des grenadiers de la Garde, avant de devenir fusiliers-grenadiers. Or, la tenue de ce régiment, au début de son existence, nous est connue par un dessin de la suite d'Otto. Et ce fusilier-grenadier, logiquement un ancien vélite de la garde, porte un habit à revers blancs passepoilés de rouge. |
![]()